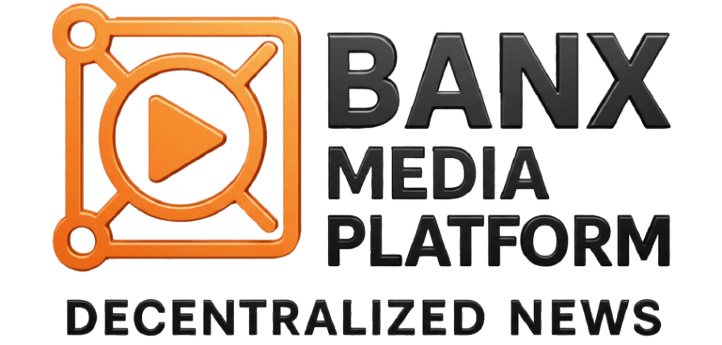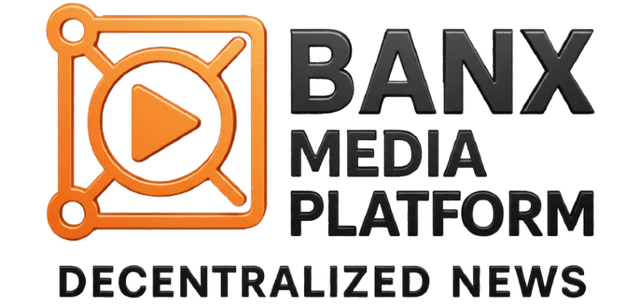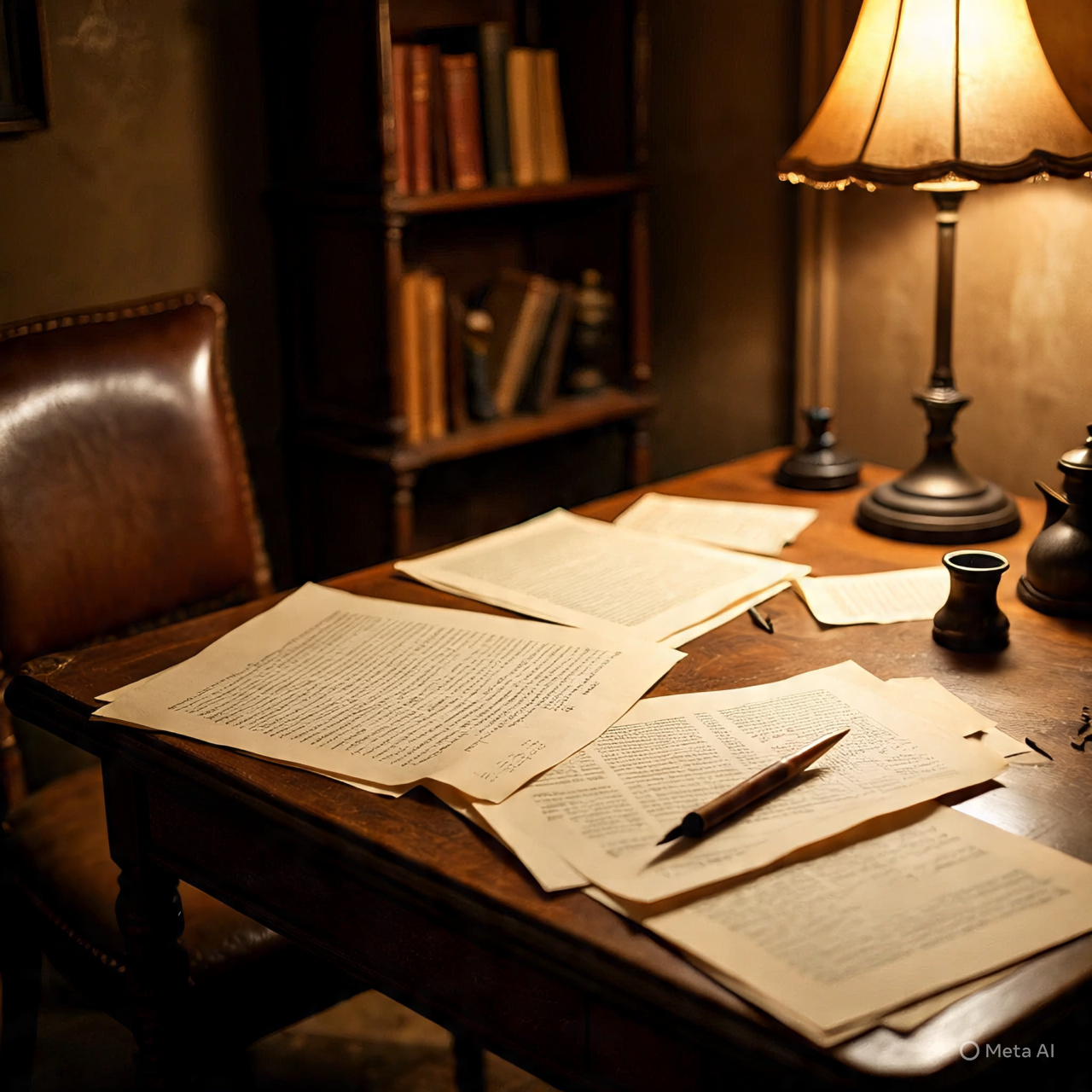Lorsque le nom de David Szalay a été appelé lors de la cérémonie du Prix Booker, les applaudissements n'ont pas retenti avec fracas, mais avec la révérence silencieuse réservée aux écrivains qui font parler le silence. Son roman gagnant, *Flesh*, est une étude de la fragilité humaine — non pas à travers un grand drame, mais à travers l'érosion douce du temps, de la mémoire et du corps lui-même.
Dans *Flesh*, Szalay transforme le quotidien en quelque chose de presque sacré. Le roman retrace des vies entrecroisées liées par le vieillissement, le désir et la prise de conscience inconfortable que l'existence elle-même est un arrangement temporaire. Ce n'est pas un livre qui crie ; il s'attarde. À travers une prose claire et une empathie désarmante, Szalay capture la texture de la solitude moderne — la façon dont les gens cherchent un sens dans des gestes trop petits pour l'histoire, mais trop humains pour être oubliés.
Les juges du Booker ont qualifié *Flesh* de "révolution silencieuse dans la fiction contemporaine", louant sa retenue et sa précision. Szalay, connu pour des œuvres comme *All That Man Is* et *Turbulence*, a longtemps été un écrivain des intérieurs — des esprits, des silences, des désirs inexprimés. Sa victoire signale un changement loin des politiques bruyantes et des récits maximalistes qui dominent souvent les prix littéraires, vers quelque chose de plus intime et existentiel.
Né au Canada et élevé en Grande-Bretagne et en Hongrie, Szalay écrit avec le détachement calme d'un outsider. Son langage est discipliné, ses thèmes sans frontières. Dans *Flesh*, il amène les lecteurs dans des pièces où l'amour s'estompe, l'ambition se dissout, et le corps — autrefois un vaisseau de but — devient une horloge. Pourtant, il y a de la grâce dans cette décadence. Sous la mélancolie se cache l'acceptation : vivre, c'est s'user, et en parler honnêtement est une forme de miséricorde.
Alors que les projecteurs du Booker s'éteignent, *Flesh* perdurera probablement non pas pour son spectacle mais pour sa sensibilité. À une époque de bruit numérique et d'expression performative, la prose de Szalay nous rappelle quelque chose de radical — que la littérature, à son meilleur, n'a pas besoin de crier pour être entendue.