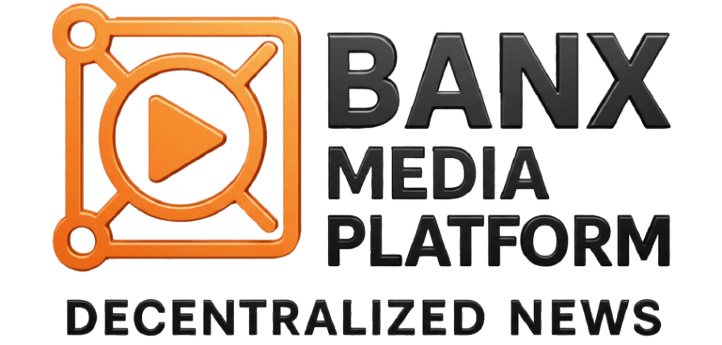Au crépuscule, les rues d'Iran portent souvent une tension familière. Les magasins baissent leurs volets à moitié, le trafic s'amenuise et les voix s'apaisent alors que la soirée s'installe. C'est dans ces heures intermédiaires—ni totalement publiques ni entièrement privées—que la protestation a trouvé son rythme ces derniers mois. Et c'est ici, a déclaré un haut fonctionnaire, que les forces de sécurité ont été instruites d'agir sans retenue.
La phrase utilisée était directe : un "chèque en blanc". Selon le fonctionnaire, les forces déployées pour faire face aux manifestations ont reçu l'autorité ouverte d'utiliser la force létale contre les manifestants. L'instruction, délivrée au sein de la machinerie de l'État, a redéfini les rues non pas comme des espaces à contrôler, mais comme des zones à soumettre.
Les manifestations elles-mêmes n'étaient pas soudaines. Elles ont émergé de pressions accumulées depuis longtemps—difficultés économiques, restrictions politiques, et un écart grandissant entre la vie publique et la voix publique. Des foules se sont rassemblées dans les villes et les petites villes, parcourant des rues qui avaient déjà vu des manifestations, portant des griefs qui semblaient à la fois personnels et collectifs.
Ce qui a changé, selon le récit, c'est la réponse. Les unités de sécurité n'étaient plus liées par la prudence ou les protocoles d'escalade. L'intention était la dissuasion par la force, et le résultat était un bain de sang. Les bilans de morts restent contestés, filtrés à travers des déclarations officielles, des témoignages indépendants, et le silence qui suit souvent la violence de masse. Ce qui est clair, c'est que beaucoup ne sont pas rentrés chez eux.
Dans les jours qui ont suivi, les quartiers sont devenus plus calmes, mais pas apaisés. Les familles cherchaient des proches disparus. Les détentions se sont étendues. Les funérailles étaient organisées rapidement, parfois sans préavis public. La peur s'est installée de manière inégale, redéfinissant les routines quotidiennes et les conversations derrière des portes closes.
L'autorisation de la force sans contrôle entraîne des conséquences au-delà du moment immédiat. Elle modifie la relation entre l'État et ses citoyens, remplaçant l'incertitude par quelque chose de plus froid : la connaissance que la protestation elle-même peut être considérée comme un acte létal. L'ordre, autrefois justifié comme protection, devient indistinguable de la punition.
Les responsables ont défendu la répression comme nécessaire pour rétablir la stabilité. Les critiques soutiennent que la stabilité imposée par la violence est fragile, soutenue uniquement par le silence et l'épuisement. Entre ces positions se trouve une société absorbant la perte tout en étant invitée à avancer.
Alors que la nuit revient dans les rues, les affrontements immédiats se sont estompés, mais leur empreinte demeure. Les murs ont été repeints. Les rues nettoyées. Pourtant, la mémoire ne s'efface pas si facilement. L'autorisation de tuer, une fois donnée, persiste non seulement dans la politique mais aussi dans la conscience publique.
Ce qui vient ensuite est incertain. Mais le silence qui suit de tels moments est rarement vide. Il est rempli de noms, d'absences et de questions qui ne se dissolvent pas avec le temps. Dans ce silence, le sens de l'autorité, de l'obéissance et de la dissidence est en train d'être reconsidéré—lentement, en privé, et à un grand coût.
Avertissement sur les images AI
Les visuels sont générés par IA et servent de représentations conceptuelles.
Sources
Fonctionnaires gouvernementaux supérieurs Observateurs des droits de l'homme Analystes régionaux Agences de presse internationales