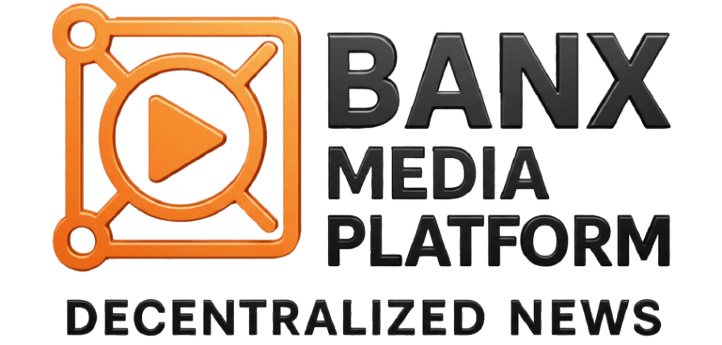À la périphérie des villes iraniennes, où les cimetières s'étendent vers la poussière et les collines basses, l'air porte une tranquillité particulière. Le vent se déplace légèrement à travers les rangées de pierres tombales. Les noms sont gravés. Les dates sont brèves. Dans de nombreux endroits, des fleurs apparaissent sans cérémonie, placées rapidement, parfois anonymement, comme si même la couleur pouvait attirer l'attention.
Le chagrin, ici, a appris à garder un profil bas.
Les familles des manifestants tués lors des récentes vagues de troubles en Iran affirment qu'elles sont sous pression pour se taire, même sur les tombes de leurs propres enfants. Les visites sont surveillées. Les rassemblements sont découragés ou dispersés. Dans certains cas, les endeuillés disent que des forces de sécurité ou des agents en civil restent à proximité, observant qui vient et qui s'attarde.
Le message, disent-ils, est tacite mais indiscutable : souvenez-vous discrètement, si tant est que vous le fassiez.
Les groupes de défense des droits de l'homme et les activistes ont documenté des dizaines de cas dans lesquels des familles ont été averties de ne pas organiser de mémoriaux publics ou de parler aux médias. Certains ont été informés que leurs proches ne devaient pas être décrits comme des manifestants. D'autres ont été invités à signer des déclarations s'engageant à ne pas poursuivre d'actions en justice ou à ne pas médiatiser les circonstances entourant les décès.
Ces décès ont émergé des manifestations nationales qui ont éclaté après la mort d'une jeune femme en garde à vue en 2022. Les manifestations se sont répandues à travers les villes et les villages, attirant des participants de divers horizons. Les forces de sécurité ont réagi avec force. Des centaines ont été tués, selon les organisations de droits. Des milliers ont été arrêtés.
Pour de nombreuses familles, le traumatisme ne s'est pas terminé avec l'enterrement.
Les mères décrivent des visites aux cimetières à l'aube pour éviter l'attention. Les pères disent qu'ils laissent leurs téléphones à la maison, craignant que des conversations puissent être enregistrées. Certaines familles marquent les anniversaires derrière des portes closes, allumant des bougies dans des cuisines plutôt qu'aux tombes.
Le deuil public, autrefois pierre angulaire de la vie communautaire, est devenu un risque.
Les autorités iraniennes ont répété que les forces de sécurité agissaient légalement et ont blâmé les troubles sur l'ingérence étrangère et des éléments violents. Les responsables commentent rarement des cas individuels. Les enquêtes, lorsqu'elles sont annoncées, sont opaques.
Le résultat est un écart croissant entre les récits officiels et la mémoire privée.
Dans des villes comme Téhéran, Chiraz, Sanandaj et Mashhad, de petits actes de mémoire se produisent encore. Une prière murmurée. Une photographie partagée discrètement entre amis de confiance. Un nom prononcé en passant, rapidement, avant que la conversation ne change.
Le chagrin s'adapte.
Les psychologues et sociologues affirment que la suppression prolongée du deuil peut approfondir le traumatisme. Les rituels existent non seulement pour honorer les morts, mais pour aider les vivants à continuer. Lorsque ces rituels sont niés, la tristesse ne disparaît pas. Elle s'installe à l'intérieur.
Pour les familles des défunts, le silence n'est pas la paix. C'est la survie.
Certains parents disent craindre de perdre leur emploi. D'autres s'inquiètent pour les jeunes enfants encore à la maison. Quelques-uns ont déjà été confrontés à des détentions ou des interrogatoires après avoir pris la parole.
Pourtant, sous le silence imposé, la mémoire persiste.
Une mère se souvient de la façon dont son fils riait. Une sœur se souvient des écouteurs empruntés et de la musique tard dans la nuit. Un père se souvient d'un message texte qui disait seulement : "Je rentre bientôt."
Ils tiennent ces souvenirs avec soin, comme des objets fragiles qui ne doivent pas être lâchés.
En dehors de l'Iran, des activistes exilés continuent de publier des noms et de documenter des cas. À l'intérieur du pays, les familles traversent la vie quotidienne en portant deux fardeaux : l'absence de quelqu'un qu'elles aimaient et l'impossibilité de parler librement de la raison de cette absence.
Aux tombes, la terre semble ordinaire. Sol brun. Pierres simples. Pas de banderoles. Pas de chants. Pas de foules.
Mais le silence n'est pas un vide.
Il est plein de mots non dits.
Et dans un pays où les voix sont contraintes, le chagrin lui-même est devenu une forme de témoignage — un témoignage qui respire doucement, attendant un moment où il pourra s'exprimer à haute voix.